Actualités

Entretien avec Dominique Dumet, conseillère partenariat avec l'Afrique : « Une politique au service d’une science partagée »
Face aux bouleversements climatiques, sociaux et sanitaires, l’IRD approfondit sa politique de partenariat scientifique avec l’Afrique dont l'objectif est de renforcer la résilience des sociétés africaines en s’appuyant sur une science durable, coconstruite et ouverte. Dans ce contexte, Dominique Dumet, conseillère scientifique Afrique à l’institut, nous expose les grands axes de cette politique renouvelée et les perspectives concrètes qu’elle ouvre pour les années à venir.
Entretien avec Dominique Dumet, conseillère scientifique Afrique
Depuis quand occupez-vous le rôle de conseillère partenariat avec l'Afrique et quels sont vos grands objectifs dans ce cadre ?
J’occupe ce poste depuis le 1er septembre 2023. Ma mission consiste à promouvoir une vision continentale de notre action en Afrique, à suivre l’évolution de nos relations partenariales, à identifier les principaux moteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du continent et à proposer des orientations pour notre politique partenariale, notamment dans sa dimension multilatérale.
Quel a été le cheminement de la stratégie Afrique 2024 à la publication de la nouvelle politique de partenariat scientifique ? Comment ces documents (stratégie, politique, chantiers régionaux) s’articulent-ils ?
Il ne s’agit pas d’une rupture stratégique, mais d’une évolution renforcée. La stratégie Afrique, validée en conseil d’administration en décembre 2022, s’inscrit dans le prolongement de la recommandation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), qui appelait à optimiser le dispositif de l’institut et à l’adapter aux transformations du paysage de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’éducation. Elle répond également à l’action 6 du contrat d’objectifs, de moyens et de performances 2021-2025, qui prévoyait la définition de stratégies régionales, dont une stratégie spécifique pour l’Afrique.
La stratégie Afrique cartographie l’action globale que l’institut réalise sur le continent africain et propose de grandes orientations. La politique de partenariat scientifique avec l’Afrique se concentre sur notre approche partenariale ; c’est une déclinaison de la stratégie Afrique qui contextualise nos orientations et propose des approches concrètes pour modifier notre trajectoire africaine, avec un objectif clé (en plus des objectifs institutionnels communs à toutes les régions) de contribuer davantage au rééquilibrage de l’écosystème mondial de la science et de la recherche.
Les chantiers régionaux sont un des livrables spécifiques de la politique de partenariat avec l’Afrique. En effet, pour s’engager davantage dans des actions transnationales, il nous a semblé indispensable d’identifier les axes scientifiques majeurs (ou chantiers régionaux) sur lesquels nous travaillons aujourd’hui en partenariat. En d’autres termes, les axes sur lesquels nous et nos partenaires du Sud avons investi ces dernières années à travers des projets, instruments, initiatives coconstruits. Seize axes ont ainsi été définis au travers de divers ateliers de consultations collectives et individuelles ayant mobilisé notamment la Direction des relations internationales et de l'Europe, les représentants et correspondants de l’institut en Afrique, les départements scientifiques, la gouvernance et divers autres représentants (communautés de savoirs – CoSav, missions, conseil d'orientation stratégique, etc.).
En quoi cette nouvelle politique fait-elle évoluer la façon dont l’institut construit ses partenariats avec l’Afrique ?
Nos actions institutionnelles sont aujourd’hui principalement menées dans des approches bilatérales, c’est-à-dire pays-centrées, majoritairement dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et centrale et en Méditerranée. Elles contribuent ainsi à la structuration de l’espace de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) des pays partenaires, à l’exception des Réseaux Internationaux de Recherche (International Research Networks – IRNs) qui sont déployés à l’échelle régionale. Nous souhaitons désormais participer plus activement à la construction de l’espace transnational de la recherche, autrement dit renforcer et promouvoir les partenariats Sud-Sud. La politique de partenariat propose des voies d’action pour renforcer ces collaborations multilatérales centrées sur le Sud.
Pourquoi ce choix d’une approche régionale et comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ?
Notre politique de partenariat avec l’Afrique est alignée avec le souhait affiché d’intégration régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche par de nombreuses institutions africaines, à commencer par l’Union africaine et son Agenda 2063, qui plaide pour des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche intégrés, la création d’un espace africain de l’enseignement supérieur, la mobilité académique des étudiants, enseignants et chercheurs, ainsi que la promotion de centres d’excellence régionaux.
À l’échelle de l’institut, cette attente fait écho, par exemple, à la demande de renforcer les mobilités Sud à travers nos dispositifs, exprimée notamment lors de l’atelier bilan des Laboratoires Mixtes Internationaux ainsi que dans divers comités de pilotage stratégiques et scientifiques.
Il est important de rappeler ici que l’approche régionale n’exclut en rien les approches bilatérales, qui restent le socle de nos constructions multilatérales.
Quelles sont les prochaines étapes de mise en œuvre ?
Les étapes à venir consistent à entamer ou à poursuivre un dialogue avec, par exemple, l’Union africaine pour explorer ensemble comment contribuer davantage à son agenda en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’agit également, à plus ou moins court terme, de faire évoluer nos instruments de partenariat pour favoriser ces liens transnationaux entre acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il s’agit aussi de coconstruire, avec les entités régionales, des plaidoyers à destination des décideurs, de lever des fonds pour contribuer à des initiatives à portée régionale, voire continentale.
Quels résultats concrets espérez-vous voir d’ici 2 à 3 ans ?
Nous espérons voir émerger des instruments de partenariat à portée régionale, tels que des Laboratoires Mixtes Internationaux intégrant une dimension régionale.
L’institut souhaite également accroître son implication et sa visibilité dans les agendas des structures africaines d’enseignement supérieur et de recherche, notamment en participant à la construction ou à la consolidation de pôles d’excellence et de plateformes de recherche régionales mutualisées. Nous visons aussi la mise en place de voies de dialogue institutionnalisées avec les entités régionales.
Enfin, une redistribution plus équilibrée de nos actions est attendue entre les pays anglophones, francophones et lusophones, ainsi qu’entre les différentes grandes régions du continent africain.
Une ambition partagée pour une science ouverte, durable et codéveloppée
Cette politique traduit donc la volonté de l’institut d’être un acteur engagé, fiable et à l’écoute de ses partenaires africains. En conjuguant excellence scientifique, ouverture et coopération régionale, l’institut souhaite coconstruire des solutions adaptées aux défis sociétaux majeurs, renforcer l’autonomie scientifique des acteurs locaux et contribuer à une science au service du développement durable. La mobilisation autour de priorités comme la transition énergétique, la santé, la biodiversité ou encore la fracture numérique témoigne d’une vision partagée d’une recherche responsable, inclusive et ancrée dans les réalités du continent.
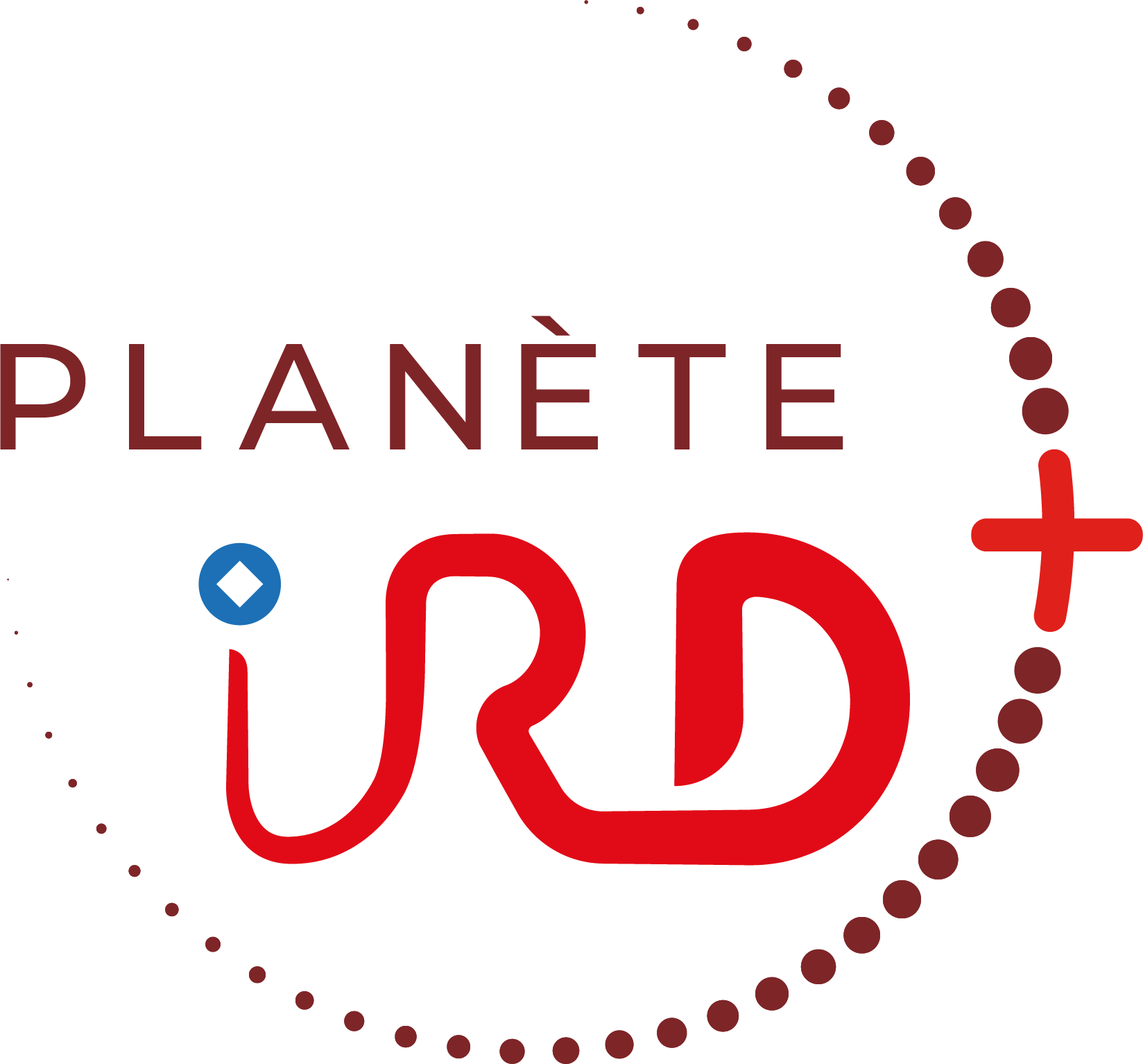

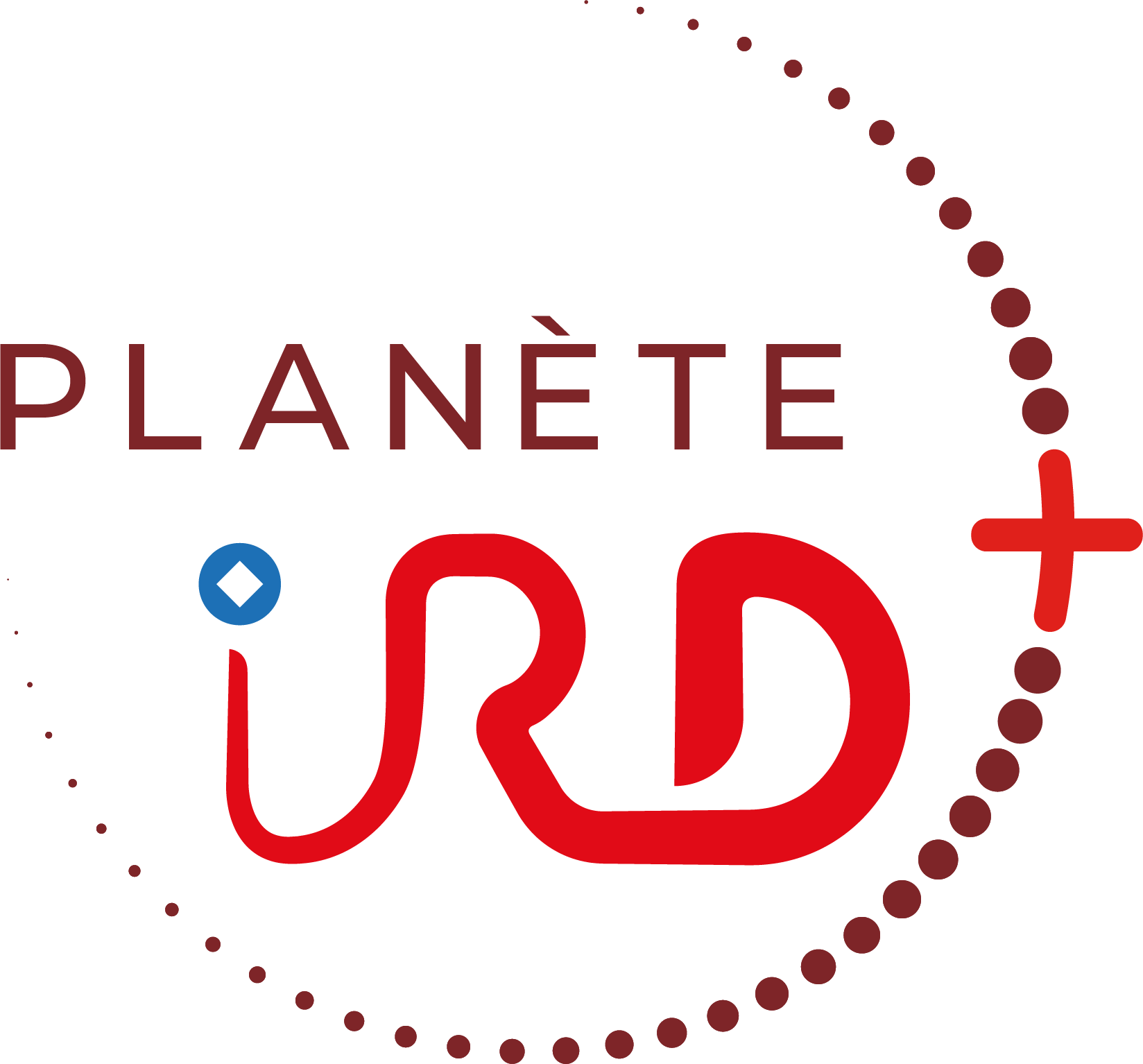






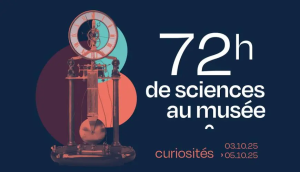



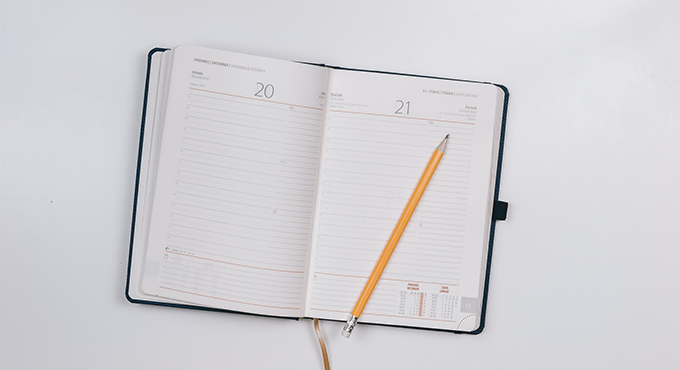
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.